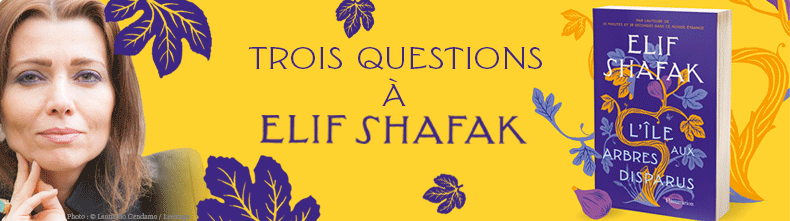Accueil > Actualités > Trois questions à Elif Shafak - L’Île aux arbres disparus
Trois questions à Elif Shafak
12/01/2022À l'occasion de la parution de son nouveau roman, L’Île aux arbres disparus, Elif Shafak nous en dit plus sur son nouveau roman engagé.
L’Île aux arbres disparus est un roman qui parle d’amour à une époque de division, de polarisation et de haine. Il traite de la partition, des violences ethniques et de la manière dont la mémoire d’un traumatisme se transmet à travers ce que l’on se raconte dans une famille mais aussi ce que l’on tait. Cela parle de souffrance héréditaire et de souvenirs transmis de génération en génération. En tant que romancière, je m’intéresse toujours aux histoires qui ont été passées sous silence, effacées, censurées et rejetées aux marges de la société. En d’autres termes, je m’intéresse non seulement aux histoires, mais aussi aux silences.
À Chypre, il existe une ligne de démarcation, gardée par les casques bleus. C’est une frontière qui divise l’île, séparant les chrétiens des musulmans, les Grecs des Turcs. La division est donc tracée par des frontières religieuses, nationales et ethniques. La littérature est pour moi une manière de m’élever au-delà de toutes barrières et de tout cloisonnement afin de mettre le doigt sur ce qu’on a en commun en tant qu’êtres humains. C’est pourquoi je parle de choses qui voyagent au-delà des frontières, comme les histoires, les superstitions, la nourriture, la musique, les oiseaux migrateurs, etc.
Un autre élément important dans ce livre est la mémoire. Je suis originaire de Turquie, un pays à l’histoire très ancienne et riche mais à la mémoire pauvre. Nous les Turcs sommes une société frappée d’amnésie collective. Notre relation au passé est pleine de ruptures, de vides. Dans mes romans, j’écris sur ces vides.
La mémoire est aussi importante dans la mesure où, à Chypre, il existe une organisation bicommunautaire créée par les Nations Unies. Il s’agit du Comité des personnes disparues. J’ai beaucoup de respect pour cette organisation au sein de laquelle les Chypriotes grecs et turcs travaillent ensemble. Il y a beaucoup de femmes et de jeunes, des personnes de différentes professions, des anthropologues, des experts médico-légaux, des étudiants… Ils creusent le sol à la recherche des ossements des personnes portées disparues à l’époque des troubles. Leur but est de retrouver les corps afin de leur offrir un enterrement digne de ce nom, et de donner aux familles des victimes une chance de faire leur deuil et de cicatriser leurs blessures. Ils ont joué un rôle important non seulement à Chypre mais aussi au Guatemala, au Chili, en Argentine, en Bosnie après le génocide, et récemment en Irak après le génocide des Yézidis… ils sont si nombreux à creuser à la recherche des ossements de leurs ancêtres. La mémoire a de l’importance. En tant que sociétés et individus, si nous ne nous rappelons pas, nous ne pouvons réparer ce qui est brisé, et ce qu’il est impossible de réparer, nous sommes condamnés à le reproduire. Ce sont là des thèmes universels.
Je voulais écrire sur Chypre depuis très, très longtemps. C’est une île fabuleuse, et ses habitants le sont tout autant, au nord comme au sud. J’aime Chypre profondément. Mais son histoire est aussi très compliquée, difficile à raconter, précisément car le passé n’est pas de l’histoire ancienne là-bas. Tout au contraire, il continue de vivre à travers le présent. Il y a des blessures qui ne sont pas guéries, des souvenirs discordants. Le passé diverge en fonction de qui le raconte, et de qui n’en a pas l’occasion. Le Nord et le Sud ont donc des mémoires complètement différentes de leur passé commun.
En tant qu’écrivain, comment aborder une histoire si complexe ? Comment raconter l’histoire d’un lieu ravagé par la partition, les divisions et les violences ethniques sans tomber soi-même dans le piège du nationalisme et du tribalisme ? Pendant des années, je n’ai pu trouver le bon angle d’approche. Je lisais, faisais des recherches, prenais des notes et y réfléchissais, mais je ne parvenais pas à trouver la brèche – jusqu’au figuier. Le figuier m’a donné une perspective différente, s’affranchissant de celles, étriquées, du chauvinisme et du nationalisme, une perspective plus apaisée, avec plus de recul, dont j’avais besoin pour écrire. Les arbres vivent plus longtemps que nous et sont connectés à la fois en dessous et au-dessus du sol. Nous pensons que nous sommes le centre de l’univers, mais du point de vue d’un arbre tout est interconnecté et fait partie d’un écosystème. Les arbres sont vraiment remarquables et nous avons beaucoup de choses à apprendre d’eux.
Je pense beaucoup aux questions d’appartenance, d’enracinement, d’exil. Ce que cela signifie d’être enraciné, ce que cela fait d’être déraciné, s’il est possible de se réenraciner ? Peut-on avoir des racines multiples, ou se les représenter autrement – au lieu des racines enterrées sous le sol, des branches qui s’étirent dans le ciel et profitent du soleil et de la pluie ? En tant qu’êtres humains, à quel point la terre d’où nous venons nous modèle-t-elle ?
Toutes ces questions ont énormément d’importance pour moi, à un niveau intellectuel et personnel. Je sais ce que c’est que d’être une immigrante, une exilée. Je fais la navette entre les cultures et les langues. J’écris en anglais mais ce n’est pas ma langue maternelle, je ne suis pas devenue bilingue en grandissant. Je porte Istanbul en moi mais je n’y retourne plus et je suis habitée par une mélancolie dont il m’est difficile de parler. La question de l’appartenance et de l’exil est donc très importante pour moi, comme je sais qu’elle l’est pour des millions d’autres personnes. Notre ère est celle des migrations, du mouvement, des déplacements qui sont loin d’être faciles et je veux raconter l’histoire des gens qui ont des appartenances multiples et qui luttent pour se faire entendre.
Livre associé